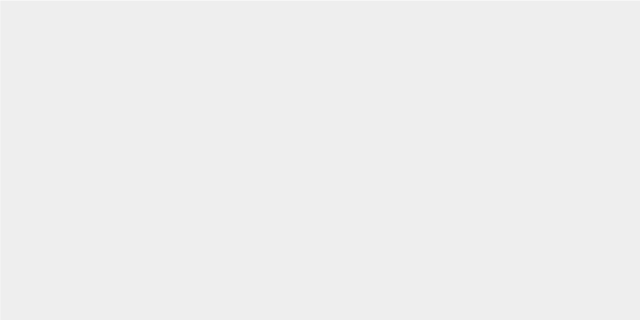
To Rome With Love
Rome Express
Réalisateur : Woody Allen
Avec : Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Jesse Eisenberg, Ellen Page…
Genre : Comédie Rome-anesque
Durée : 107 minutes
Sortie française : Juillet 2012
Synopsis
To Rome With Love nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes histoires de personnages, de simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et quiproquos.
Critique
 Après sa déclaration d’amour à un Paris idéalisé et romantique dans le réussi Minuit à Paris, Woody Allen continue son voyage européen en Italie. Rome, c’est la ville ouverte, au potentiel cinématographique référencé, mythologique, une porte pour l’héritage historique et artistique. Autant d’éléments laissés de côté par le réalisateur, alors qu’ils auraient pu donner un peu plus de substance à son film.
Après sa déclaration d’amour à un Paris idéalisé et romantique dans le réussi Minuit à Paris, Woody Allen continue son voyage européen en Italie. Rome, c’est la ville ouverte, au potentiel cinématographique référencé, mythologique, une porte pour l’héritage historique et artistique. Autant d’éléments laissés de côté par le réalisateur, alors qu’ils auraient pu donner un peu plus de substance à son film.
On se retrouve devant un film choral somme toute très classique. Rome, vue par le parcours de plusieurs de ses habitants ou touristes. Allen est un familier de ces destins croisés, se rapprochant de Klapisch (Paris), Jeunet (Amélie Poulain) ou, dans une veine plus sombre, Iñárritu (Babel, 21 Grammes…). Mais là où Iñárritu enchevêtre les destins de ses personnages, les relient les uns aux autres par des éléments plus ou moins directs, Woody Allen n’utilise pas ce réseau de liens, ce genre d’effet papillon, et choisit la juxtaposition de « petites histoires » de chacun dans la ville éternelle.
Pizza YOLO
D’où une impression de film à sketches, qui s’interrompent les uns les autres et n’ont comme liant que le thème principal qui se dégage du film : le rapport ou le retour à la normalité, et la ville dans laquelle se déroule leur histoire, mais qui est peu exploitée. Du nombre de narrations parallèles découle un problème de rythme. Il y en a au moins quatre, si on ne considère que les segments comme regroupement d’acteurs. Jack, qui tombe amoureux de Monica, le couple provincial Antonio/Milly, la rencontre entre américains et italiens autour du couple Michelangelo/Hayley, et enfin la propulsion de Leopoldo, citoyen ordinaire, sur le devant de la scène. Mais ces axes principaux sont eux-mêmes sous-segmentés, séparant les personnages des segments principaux avant de les réunir.
Ne s’attachant que peu de temps à chacun, la caméra perd le spectateur en ne proposant q’une surface, un enchaînement d’instantanés. C’est sans doute le but d’Allen, qui respecte comme rythme l’évolution du rapport à la réalité et à la popularité. C’est celui-ci qui dicte les changements de segments, qui se déroulent donc chacune en parallèles sans jamais s’enrichir. Le souci, c’est qu’aucune des intrigues n’est assez forte pour rester en tête, ni assez légère pour proposer une simple atmosphère qui ferait alors de Rome le réel cœur du film.
Rome, t’y vas quand ?
Bien sûr, comme ça reste du Woody Allen, on retrouve des thèmes qui relèvent chez lui de l’obsession, traités ici sans ostentation. Le principal, le ressort du film, c’est ce rapport à la popularité n’aboutissant qu’à un retour vers la simplicité, variablement vécu par les personnages (libération, résignation, destruction). Pas grand chose à dire sur le casting qui remplit son rôle sans briller particulièrement.
Très agréable Eisenberg hésitant entre passion et raison, dont le physique maladroit aux épaules crispées correspond tout à fait. Begnini, stéréotype même de la figure de télé-réalité projetée sans raison au devant de la scène, consulté sur tout alors que son opinion ne valait rien, avant d’être éjecté (rejet désiré puis regretté : illustration des névroses que la situation peut engendrer), ne brille pas spécialement, fait « juste » du Begnini, donc des tonnes. Moins marquant aussi est le segment Milly/Antonio, que ce soit dans le traitement du thème ou dans ses personnages et acteurs (Pénélope Cruz trop attendue, manque d’inventivité). Allen, acteur, est dans un de ses rôles les plus faibles, cabotine sans convaincre, l’acteur interprétant Michelangelo (Flavio Parenti) agace plus que de raison, et finalement de ce segment n’est à sauver que le rôle du père (Fabio Armiliato), celui qui opère le parcours popularité-retour à la normale après quelques très beaux moments sur scène (celle où Allen l’entend dans la douche la première fois étant l’une des plus belles du film). Alec Baldwin a le rôle au plus gros potentiel, en Jiminy Cricket de Jack. Personnage d’arrière-plan, interprété de manière transparente, il propose une vision pleine d’autodérision sur le métier d’acteur (« vendu ») et le monde artistique de manière général. Il est à la fois un futur potentiel de Jack, l’aboutissement d’une Monica, interprétée par une Ellen Page impeccable. Ce segment est le seul qui rappelle vaguement le voyage temporel de Minuit à Paris, la touche fantastique qui apporte un peu autre chose que ces simples instantanés, et dont on aurait voulu un peu plus. Le personnage de John apporte cette touche de magie, tout comme le personnage de Monica, à laquelle Jack, mais aussi Sally (Gerwig mineure et sobre) ou ses anciennes relations ne peuvent que se soumettre.
Un beau patchwork que ne relie que ce thème assez fin et dont le film a vite fait le tour, avec peu de variations, et auquel se greffent donc les obsessions de Woody : psychanalyse, relation à l’art, et bien sûr crise du couple. On aurait pu espérer que Rome soit un peu plus que juste le lieu de ces histoires, un personnage à part entière qui prendrait sa personnalité par les sketches, comme pouvait l’être Paris. Ici, à part quelques plans architecturaux ou d’ensemble qui, s’ils sont jolis, n’ont rien d’inoubliables, la ville n’apporte rien ou presque. Reste, comme dans la plupart des films de l’américain, quelques situations et dialogues croustillants.
Un film mineur dans la filmographie fournie du réalisateur (qui le voit sans doute comme « récréatif »), mais qui, comme souvent, s’y inscrit sans peine.
Amoureux de la culture au sens large, je tente de pratiquer à la fois approfondissement et élargissement, sans que jamais ce ne soit sale. Né la même année que la chute de mur de Berlin (coïncidence ? pas sûr…), j’ai été bercé par Picsou Magazine, les Tortues Ninja, les Minikeums, Pokémon ou encore Final Fantasy VII. J’ai tendance à écrire et parler plus que nécessaire, je vais donc me contenter d’ajouter que je suis aussi professeur des écoles.



Leave a Comments
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.